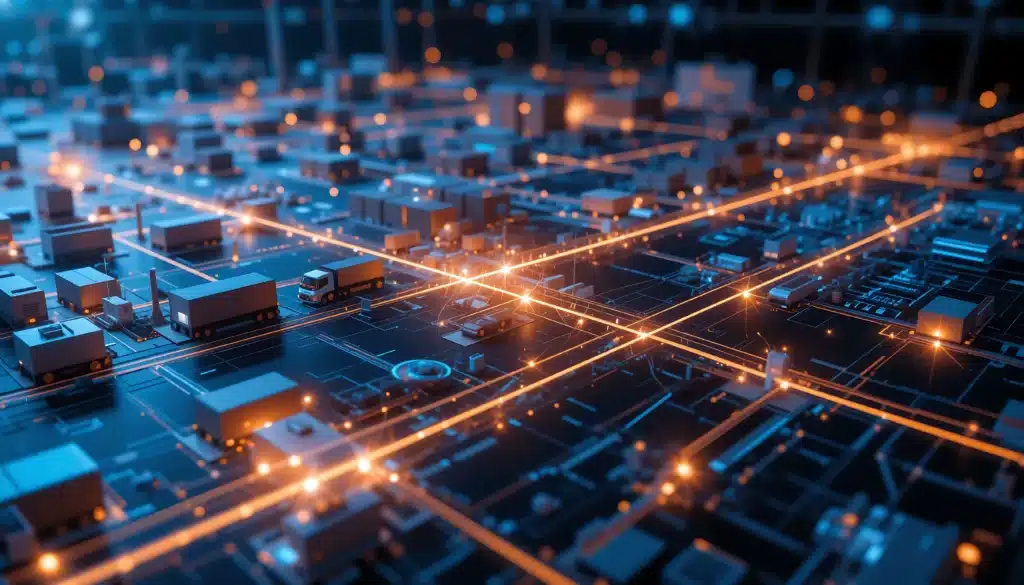#MANAGEMENT – L’Usine Nouvelle publie une interview du sociologue François Dupuy sur son dernier ouvrage « La faillite de la pensée managériale ». Extraits
(…) Le titre de votre essai fait référence à une pensée managériale. Ce terme de pensée est-il une manifestation de votre ironie ?
Quand je parle de pensée, je ne me réfère pas à un grand système d’explication du monde avec des concepts définis. Il faut entendre ce terme au sens où tous nos actes procèdent de notre façon de penser. Or, la manière dont raisonne le management est en faillite et a déjà mené certaines entreprises à la ruine.
A l’origine du phénomène, il y a la formation des managers encadrants. Un technicien qui a réussi dans sa fonction est nommé manager mais personne ne pense à le former, alors qu’il va avoir une tâche relativement complexe à réaliser, gérer des Hommes. Du côté des dirigeants, la pensée financière a tué toutes les autres formes de pensée.
Comment expliquez-vous ce choix qui semble peu raisonnable ?
Il y a une forme de paresse intellectuelle terrifiante. On ne raisonne plus, on applique des recettes. On ne creuse pas la question de l’organisation et des hommes. On se contente de la connaissance ordinaire. Or, les sciences sociales le démontrent, une organisation humaine est tellement complexe que son fonctionnement n’apparaît pas à l’oeil nu. De nombreux travaux de cette discipline ont montré comment cela marche justement. Cela revient à faire comme si les études de médecine n’existaient pas et qu’on continuait à aller voir des rebouteux. Mais si la pratique de la médecine a pû progresser, c’est parce qu’on a développé parallèlement des savoirs très complexes sur les virus par exemple.
Une chose me frappe dans les livres récents sur le management, c’est qu’on n’y parle plus du tout ou très rarement de « pouvoir ». Ce mot semble faire peur, comment l’interprétez-vous ?
Prenons l’exemple de ce qui est pour moi la catastrophe managériale majeure : la multiplication des chefs de projet, le fonctionnement « en mode projet ». On prend un brave type ou une brave fille et on lui dit « tu vas faire travailler ensemble des gens venant de services différents » et en général on ne lui donne aucun moyen pour le faire. Pourtant, on crée des postes de chef de projet pour tout et n’importe quoi. Les dirigeants semblent croire qu’il suffit de donner le titre de chef pour qu’une personne le soit, que changer l’organigramme c’est changer l’organisation. C’est bien sûr faux.
Pour les sciences sociales, avoir du pouvoir c’est contrôler quelque chose d’important pour les gens qui vont travailler ensemble. Comment voulez-vous que la personne nommée chef de projet ait une quelconque autorité si elle ne contrôle pas une ressource stratégique?
Comme on ne pense pas ces questions, on pratique soit la coercition soit l’incantation. La première se manifeste par tous les systèmes de contrôle et de reporting. Pour la seconde, vous avez tous ces chefs d’entreprise qui deviennent des sortes de gourous (il ne leurs manque que la robe blanche) expliquant les valeurs fondamentales de l’entreprise. Comme si les gens se comportaient en fonction des valeurs de l’entreprise ! Pourtant, les sciences sociales (encore elles !) ont établi depuis longtemps que les valeurs sont le résultat d’une action, pas quelque chose qu’on impose.
Vous raillez beaucoup dans votre lire le discours sur les valeurs.
Rendez-vous compte. Quand on les étudie, on découvre que la valeur la plus souvent mentionnée dans les entreprises est l’innovation. Or que voit-on ? Une multiplication des systèmes de contrôle, un enfermement de l’action dans ces systèmes. Comment voulez vous que les personnes innovent ? Le résultat de cette contradiction est de créer du cynisme. Les salariés feignent d’approuver mais ils continuent comme avant.
(…)N’évacuez-vous pas un peu vite l’hypothèse que les dirigeants sont rationnels, puisqu’ils sont soumis à une logique financière, ils s’y conforment tout simplement ?
Ils ont fait le choix de s’ajuster à une seule variable, la finance. Mais parallèlement, ils s’aperçoivent du désengagement des salariés et des problèmes que cela pose. Pour revenir aux valeurs, l’engagement est la deuxième valeur la plus citée dans les entreprises européennes. Cela fait quinze ans là aussi que les sociologues parlent de ces phénomènes. Bien sûr que l’engagement (défini comme mettre dans son travail un peu plus de soi que ce que prévoit le contrat de travail) est un facteur de productivité. Aujourd’hui, de plus en plus de salariés préfèrent mettre ce surplus ailleurs que dans l’entreprise, dans l’associatif, le non marchand… Ils se désintéressent du gain monétaire. Le désengagement va coûter très cher aux entreprises. Philippe Aghion avait calculé le coût de la défiance, j’attends qu’on mesure celui des effets de la pensée paresseuse avec impatience.
Comment favorise-t-on l’engagement ?
Comment voulez vous que les salariés soient engagés si vous leur faites passer en permanence le message que vous ne leur faites pas confiance, comme en attestent tous les systèmes coercitifs pour les surveiller, pour encadrer leur travail… Il y a des gens qui vous disent point par point ce que vous devez faire, et il faudrait s’engager, c’est-à-dire donner un peu de soi ? Il faut des dispositifs concrets, comme des récompenses, des modèles, qui favorisent cet engagement et pas un énième discours sur les valeurs. A ce sujet, je ne résiste pas à vous raconter cette anecdote : j’ai vu une entreprise, où on imprime les valeurs au dos du badge d’accès. Comme ça, si vous croisez un salarié et que vous lui demandez les valeurs, il a une antisèche ! (…)